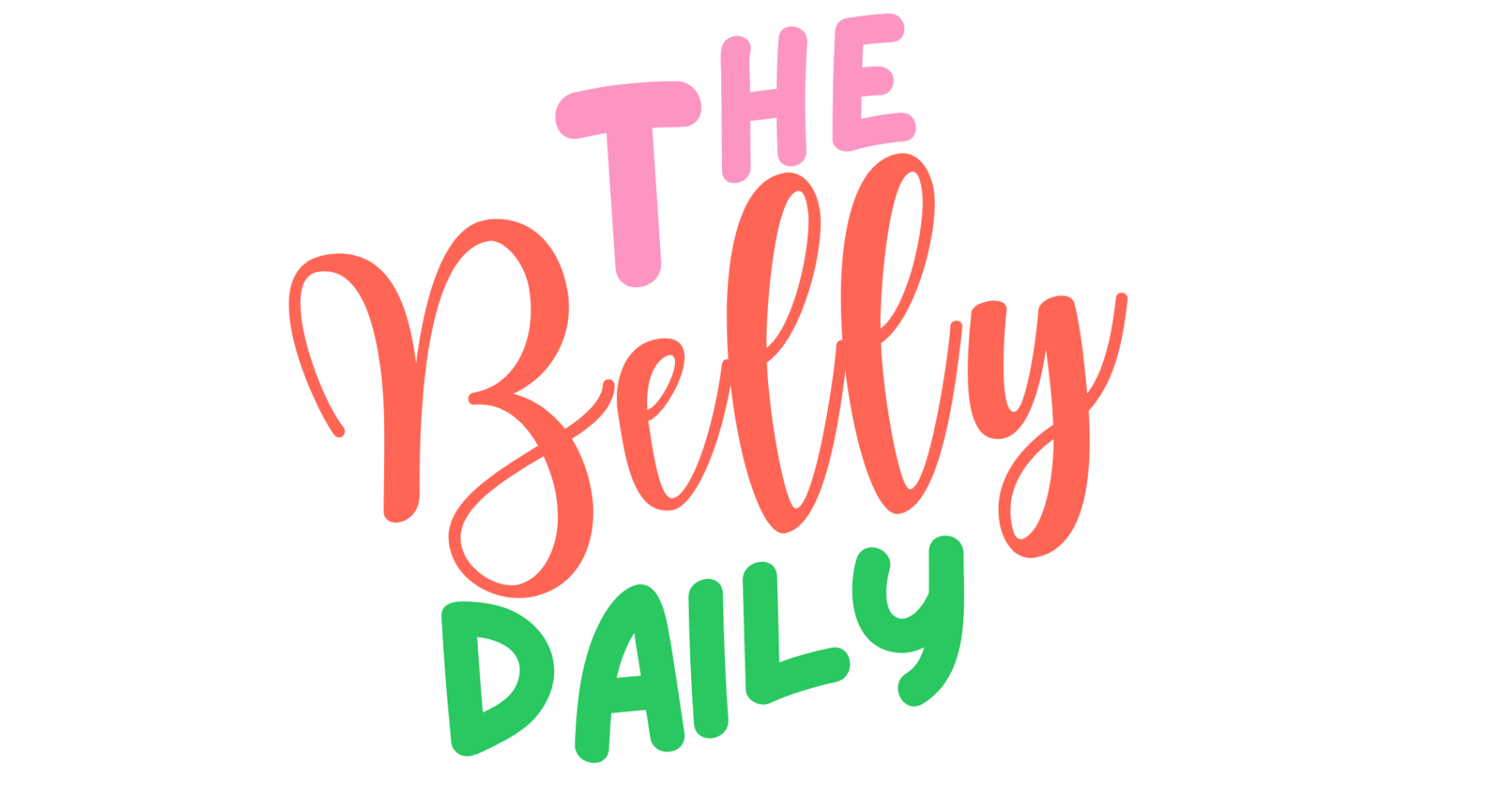Avec la mondialisation, nos assiettes se ressemblent de plus en plus, et le blé, riche en gluten, s’impose comme une base alimentaire universelle. Pourtant, tous les pays n’ont pas accueilli cette céréale à bras ouverts. Alors que certaines cultures en font le pilier de leur cuisine, d’autres continuent de s’appuyer sur des céréales naturellement sans gluten, comme le riz, le millet ou le maïs. Cette diversité alimentaire pourrait-elle expliquer des différences de santé digestive à travers le monde ? Découvrons pourquoi les régimes traditionnels résistent souvent mieux à la standardisation alimentaire.

Le blé et le gluten : une domination mondiale
Le blé est aujourd’hui la céréale la plus cultivée au monde. Selon la FAO, il représente environ 30 % des calories consommées globalement. Originaire du Croissant fertile (l’actuel Moyen-Orient), il a été exporté massivement lors de la colonisation européenne et a progressivement remplacé d’autres cultures traditionnelles.
Cette domination s’explique par plusieurs facteurs :
- Rendement élevé : Le blé moderne, sélectionné pour sa productivité, offre des récoltes abondantes.
- Adaptabilité : Il pousse dans des climats variés et peut être transformé en une multitude de produits (pain, pâtes, biscuits).
- Industrie agroalimentaire : Le gluten, qui confère élasticité et texture, est indispensable dans les procédés industriels pour fabriquer des aliments transformés.
Les régimes traditionnels : des alternatives sans gluten
Dans de nombreuses régions du monde, les céréales naturellement sans gluten restent la base alimentaire.
- Asie : Le riz est omniprésent, consommé sous toutes ses formes. Les nouilles de riz et le riz gluant remplacent les pains et pâtes à base de blé.
- Amérique latine : Le maïs règne en maître, que ce soit sous forme de tortillas, tamales ou arepas.
- Afrique : Les céréales anciennes comme le millet, le sorgho ou le teff sont largement utilisées dans des plats comme le injera (pain éthiopien) ou les bouillies.
Ces céréales, bien que moins productives que le blé, sont souvent plus adaptées aux climats locaux et nécessitent moins de transformation pour être consommées.
Lire aussi article sur l’intolérance alimentaire
Pourquoi les régimes traditionnels semblent-ils mieux protéger la santé digestive ?
Une moindre exposition au gluten
Les populations dont le régime repose sur des aliments sans gluten consomment naturellement moins de cette protéine, ce qui réduit le risque de troubles digestifs comme l’hypersensibilité ou la maladie cœliaque. Une étude publiée dans World Journal of Gastroenterology a montré que la prévalence de la maladie cœliaque est significativement plus faible dans les pays où le blé n’est pas l’aliment principal.
Une meilleure diversité alimentaire
Les régimes traditionnels privilégient souvent des céréales variées, offrant un large éventail de fibres, vitamines et minéraux essentiels pour nourrir le microbiote intestinal. Par exemple, le millet et le sorgho, riches en fibres insolubles, favorisent un transit régulier et un microbiote diversifié.
En comparaison, les régimes occidentalisés, dominés par le blé raffiné, apportent moins de fibres et de nutriments essentiels, ce qui peut conduire à un microbiote appauvri et à des troubles digestifs.
Moins d’aliments ultra-transformés
Les cuisines traditionnelles mettent en avant des aliments entiers, préparés avec des techniques simples. En revanche, la standardisation alimentaire basée sur le blé va souvent de pair avec des aliments ultra-transformés (biscuits, pizzas, plats préparés), riches en additifs et pauvres en fibres.
Une étude publiée dans BMJ Open a révélé que les populations consommant principalement des aliments transformés ont un risque accru de développer des maladies digestives chroniques, comme le syndrome de l’intestin irritable (SII).
Des pratiques culinaires qui favorisent la digestion
Dans les régimes traditionnels, les céréales sont souvent préparées avec des techniques qui améliorent leur digestibilité :
- Fermentation : Le injera éthiopien ou le dosa indien sont fermentés, ce qui réduit les composés difficiles à digérer et améliore l’absorption des nutriments.
- Trempage et cuisson lente : Ces méthodes, fréquentes en Afrique et en Asie, réduisent les antinutriments et facilitent la digestion.
La standardisation alimentaire : un défi pour les régimes traditionnels
Avec la mondialisation, de plus en plus de pays abandonnent leurs céréales locales au profit du blé. Cette transition a des conséquences non seulement sur la santé, mais aussi sur la biodiversité agricole.
- Risque pour la santé : Une étude menée en Afrique du Sud a montré que l’introduction massive de pain à base de blé a entraîné une augmentation des troubles digestifs, notamment chez les populations non habituées à consommer du gluten.
- Érosion de la biodiversité : Les cultures locales comme le millet ou le teff sont abandonnées, ce qui fragilise les écosystèmes et réduit la résilience face au changement climatique.
Le gluten, omniprésent dans les régimes occidentaux, est une preuve de l’homogénéisation de nos habitudes alimentaires. Pourtant, les régimes traditionnels, riches en céréales naturellement sans gluten, montrent qu’il est possible de nourrir des populations tout en respectant leur santé digestive et leur patrimoine culinaire.
Face à la mondialisation, il est essentiel de préserver ces traditions et de réintroduire la diversité alimentaire dans nos assiettes. Car parfois, pour bien digérer, il suffit de revenir à des pratiques anciennes qui ont déjà fait leurs preuves.